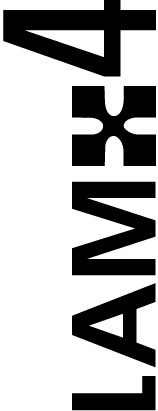Qui pourrait supporter sans souffrir un sens multiple et cependant purifié de tout « bruit » ? Le retentissement fait de l’écoute un vacarme intelligible.
Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux
Leviathan de Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel a été distribué dans les salles françaises et américaines comme un « documentaire ». Bien sûr, cette appellation générique en occulte bien des aspects. Plus qu’un documentaire, Leviathan est tout à la fois un objet plastique et visuel singulier, un film expérimental et une performance de musique noise pré-enregistrée. Depuis sa conception, il échappe aux classifications. Tourné à bord d’un chalutier par deux anthropologues du Sensory Ethnography Lab de Harvard, il est avant tout un objet théorique, plastique et sonore élaboré hors de, et contre les conventions du cinéma documentaire, souvent proche du cinéma d’avant-garde et de la musique expérimentale.
De fait, Leviathan est un objet hybride, « monstrueux » si l’on en croit ses deux géniteurs, un objet sur lequel viennent se briser les disciplines aptes à en rendre compte : filmologie, musicologie, histoire de l’art et anthropologie sont toutes renvoyées dos à dos, mise en déroute par la singularité du film. Il s’agit également d’un film où achoppent les partages admis des genres, des pratiques et des formes cinématographiques. Lucient Castaing-Taylor et Verena Paravel ont affirmé explicitement l’hybridité de leur film, tant sur le plan formel et matériel que sur le plan théorique et épistémologique :
Le Sensory Ethnography Lab regroupe une bande d’amateurs qui travaillent individuellement ou collectivement dans un même but : utiliser différentes formes de médias audiovisuels (films, vidéo, photographie, phonographie, outils hypermédia), pour faire des choses qui rassemblent les domaines de l’art et de l’anthropologie, dans des formes qui n’auraient pas été explorées par ceux qui travaillent dans ces disciplines. Nous sommes très investis dans l’ethnographie, mais nous ne partageons pas l’inclination de nos collègues anthropologues-écrivants, qui consiste à privilégier la culture par rapport au vécu. Pas plus que nous ne partageons leur tendance a traduire la complexité du monde dans la seule prose informative et propositionnelle. Nous expérimentons tous dans des formes esthétiques souvent bannies par le milieu académique, en particulier dans les sciences humaines, mais nous sommes en même temps considérablement plus attachés au réel que la plupart des artistes issus de l’art contemporain. Et alors même que nous nous intéressons au documentaire, nous faisons en sorte de nous détourner des conventions qui dominent ce genre. Généralement, ou bien les documentaires consistent en une forme lâche de cinéma-vérité qui répète sans esprit les innovations des années 60 et 70, ou bien ils appliquent les formes du journalisme télévisuel : voix-off désincarnée, témoignages d’experts, interviews, musique additionnelle, etc. Ils ont toujours tendance à privilégier la narration et la clarté discursive au détriment des affinités que le documentaire peut avoir avec les romans ou la poésie. C’est le triomphe du code, de l’information. Avec Leviathan, nous avons essayé autant que possible d’accorder une place à l’opacité de la vie. (Momcilovic, 2013)
Je vais tâcher de montrer que le bruit visuel et sonore dans Leviathan fait peser sur la représentation cinématographique – qu’elle soit sonore ou visuelle – la menace d’un indéchiffrable, dont l’effet est de mettre en crise les normes de perception et les discours anthropocentrés. Je vais ainsi évoquer Leviathan de façon à pouvoir en tirer des perspectives théoriques sur le bruit et ses effets, à la fois en termes de connaissance du monde et de production de savoirs, et donc également en termes idéologiques et politiques. Je m’appuierai sur la philosophie de l’art, la théorie critique française et les théories de la contre-culture. Surtout, je voudrais montrer, au fil de ma réflexion, en quoi Leviathan pose des questions épistémologiques d’importance aux disciplines académiques qui le sous-tendent, à savoir la philosophie et l’anthropologie.
Expérience sensorielle et désubjectivation : la représentation en déroute
Leviathan met en jeu une forme d’audio-vision singulière – ce concept vient de Michel Chion – plutôt qu’une image documentaire au sens propre. L’audio-vision désigne « la projection du son sur l’image » (Chion, 2000, p. 7), grâce à laquelle le son apporte une « valeur ajoutée » à l’image. L’audio-vision est donc l’image transformée de l’intérieur par la projection sonore ; elle est à la fois le regard appareillé par l’ouïe et l’ouïe appareillée par le regard, de manière à ce qu’apparaisse un synchronisme de la bande-son et de la bande-image sous l’effet d’un phénomène de « synchrèse », c’est-à-dire de « soudure irrésistible et spontanée […] entre un phénomène sonore et un phénomène visuel ponctuel lorsque ceux-ci tombent en même temps » (Chion, 2000, p. 55). Or, dans Leviathan, le synchronisme de la bande-image et de la bande-son est mis à mal. La synchrèse est fréquemment mise en déroute, dans une imbrication des modes et des dispositifs de perception dont l’effet est, nous allons le voir, la construction d’un corps perceptif nouveau, et, par conséquent, d’une perception du monde radicalement transformée.
Dans Leviathan, l’expérience sensorielle du spectateur est déterminée par l’usage de prises de vue basse définition issues de caméras GoPro – ces caméras portatives utilisées par les sportifs pour garder trace de leurs exploits – installées sur les mâts, dans les cales ou sur les filets du chalutier, et de prises de son basse définition (issues des micros des GoPros) et haute définition (issues d’un magnétophone de très haute qualité). Il n’y a donc pas d’opérateur à proprement parler dans Leviathan : les images et les sons sont le résultat aléatoire, ou arbitraire, d’un matériel d’enregistrement devenu autonome, et donc plus largement le résultat indirect d’une décision prise dans un souci d’expérimentation visuelle, plastique et sonore (Thély, 2007, p. 15-17). Qui plus est, la basse définition des caméras GoPro produit une illisibilité relative (parfois intense, parfois faible) de la bande-image et de la bande-son (Thély, 2012, p. 25-29 et 2007, p. 18-20). Les plans du film se caractérisent par un degré élevé de bruit visuel, tandis que la bande sonore est saturée de tous les bruits qui assaillent la caméra : le vent, la mer, le son des poissons morts qui heurtent le pont, le moteur assourdissant et la mécanique du chalutier ou encore la parole des marins. Tous ces bruits se fondent et tourbillonnent en un maelström sonore au volume élevé. Quant à la basse définition, elle masque et parasite ce qui apparaît sur la bande-image et la bande-son. L’œil et l’oreille ne peuvent plus identifier ces objets, qui tendent à se réduire à de purs phénomènes visuels et sonores, dès lors que le bruit visuel et sonore en altère la netteté (fig. 1 et 2). À l’instar du générique du film, qui mêle ensemble les noms des marins et ceux des poissons sans distinction de nature, tous les sons entendus dans Leviathan se trouvent sur le même plan, fondus en un même continuum sonore, réduits à l’état de bruits indifférenciés et indéchiffrables.

Figure 1

Figure 2
Le spectateur y fait l’expérience d’une désubjectivation radicale. Il faut entendre ce mot comme une dérivation du concept de « subjectivation » forgé par Michel Foucault (1969, p. 29)Voir aussi Artières (2004).. Au cours du processus de subjectivation, le sujet pris dans les rets des objectivations normatives imposées par le champ social (conformation de la pensée, assignation aux idéologies, normalisation sociale) se libère et s’invente comme sujet. Par le truchement de l’écriture (notamment l’écriture de soi), de la littérature, de l’art et des techniques du « souci de soi », la subjectivation propose au sujet un autre espace de pensée, tissé par des discours, des voix, des sensations qui se déploient à rebours de l’espace normé« Le souci de soi », « Le sujet et le pouvoir » et « L’écriture de soi », in (Foucault, 1994, p. 51-85, 222-243, 415-430). ; elle lui permet de « se déprendre de ces déterminations et y ménager paradoxalement l’espace (pourtant toujours interne) d’une parole ou d’un mode de vie autresPhilippe Artières, Jean-François Bert, Mathieu Potte-Bonneville et Judith Revel : « Introduction », in Foucault (2013, p. 19) ». C’est bien là l’expérience que propose Leviathan à son spectateur, mais le film pousse plus loin encore ces effets ; c’est la raison pour laquelle je propose de parler de « désubjectivation ».
Dans Leviathan, la désubjectivation met temporairement en échec les objectivations normatives du sujet sans lui permettre de se réinventer comme sujet, sans lui donner à nouveau le socle stable d’une subjectivité définie. Autrement dit, la forme singulière du film vise l’annulation de ce qui constitue le spectateur comme sujet, de ce qui le fait se concevoir et s’éprouver comme tel, à travers la disparition progressive de toutes les prérogatives du sujet classique, tel qu’il commence à se définir au cours de la Renaissance avec Francis Bacon puis dans la pensée de Descartes, sous l’impulsion nouvelle donnée aux sciences et à la technique (Delumeau, 1984, p. 149-152 et 457-458). Ces prérogatives sont la raison, l’universalité, le cogito et la vision anthropocentriste du monde, puisque Descartes considère que les sciences et la philosophie doivent permettre aux hommes de se « rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » (Descartes, 1637, p. 122). Ici, la désubjectivation signifie que le film travaille à priver le spectateur de tout regard humain et va ainsi à rebours du processus d’identification qui se joue dans la plupart des films narratifs ou documentaires et qui porte avec lui une représentation homogène et non contradictoire du réel, représentation qui est donc, a priori, réaliste. En brisant le processus d’identification, Leviathan fait également obstacle à cette représentation dite réaliste.
Comment expliquer cette déroute du réalisme ? Selon Colin MacCabe (1974, p. 12), « le texte filmique classique réaliste ne peut pas prendre en charge la dimension contradictoire du réel« The classic realist text cannot deal with the real as contradictory ». Toutes les traductions sont de moi, sauf mention contraire. ». Le réalisme ne vise donc pas le réel (cette totalité conflictuelle, hétérogène, incompréhensible et sans unité autre que celle du mot grâce auquel nous le nommons) mais la réalité, c’est-à-dire une certaine construction homogène et normée de ce réel. Le réel est chaotique, tandis que la réalité l’ordonne au sein d’un cadre de règles qui en expurgent les contradictions. Cette représentation cadrée et normée du réel est due, quant à elle, à la fonction qu’assigne au spectateur le texte filmique classique : « Dans un mouvement réciproque, le texte filmique classique réaliste assure la position du sujet dans un rapport de spécularité dominante« In a reciprocal movement the classic realist text ensures the position of the subject in a relation of dominant specularity. ». » (MacCabe, 1974, p. 12) Cette fonction repose à son tour sur la position symbolique et concrète du spectateur au sein du dispositif cinématographique. Toute la pratique de la représentation réaliste est adossée au concept de perspective, qui détermine elle-même la place du spectateur :
En incorporant la perspective dans sa machinerie de production d’images, le cinéma a maintenu vivants les « concepts culturels » qui donnent à chaque membre du public le sentiment de regarder l’image depuis un point de vue unique et privilégié, tout en restant tenu à distance de celle-ci« By incorporating perspective into its image-making apparatus, cinema has maintained the “cultural concepts” that give each members of the audience the sense of seeing the image from a privileged and unique point of view, while remaining distanced from it. ». (Wees, 1992, p. 46)
Stephen Heath a montré en quoi cette position symbolique est structurellement induite par le dispositif matériel, en parlant du « positionnement du spectateur-sujet assuré par son identification à la caméra comme point d’origine d’une vision assurée, centrale et totalisante« The positioning of the spectator-subject in an identification with the camera as the point of a sure and centrally embracing view. » » (Heath, 1981, p. 30). Au cinéma, la représentation du réel fait donc l’objet d’un paradoxe (dû probablement à l’histoire du cinéma comme art mimétique) : la représentation que le spectateur perçoit spontanément comme réaliste est celle qui reconstruit le plus le réel et qui édulcore sa dimension conflictuelle et chaotiqueVoir, à cet égard, Slavoj Žižek : « Passion of the Real, Passion of Semblance », in (Slocum 2006, p. 89-96) et (Žižek 2001, p. 19-27)..
Réciproquement, pour transmettre de manière plus juste la sensation authentique du réel, il est nécessaire d’entrer dans un processus de différenciation stylistique, voire un formalisme, ou de mettre en place des stratégies de tournage particulières, à la manière de ce que font Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel. D’après Colin MacCabe, le paradoxe de la transparence réaliste que je viens d’évoquer est dû au fait que le discours filmique impose son propre ordre et sa signification au réel en se servant du spectateur et de sa position comme d’une fonction d’ordonnancement.
Grâce aux informations que nous glanons dans le récit, nous pouvons distinguer les discours des différents personnages et leur situation, et comparer ce qui est dit dans ces discours et ce qui nous est révélé par la narration. La caméra nous montre ce qui arrive – elle dit la vérité en regard de laquelle nous jaugeons les discours« Through the knowledge we gain from the narrative we can split the discourses of the various characters from their situation and compare what is said in these discourses with what has been revealed to us through narration. The camera shows us what happens – it tells the truth against which we can measure the discourses. ». (MacCabe, 1974, p. 10)
La transparence du réalisme est due à la fonction et à la position qu’occupe le spectateur. La caméra reconstruit le réel et fournit une image non contradictoire de la réalité, mais en dernière instance c’est le spectateur qui valide la vérité particulière que lui fournit le texte filmique. Le circuit complexe par lequel s’élabore le réalisme fait que la manière dont le texte filmique impose son ordre et sa signification au réel n’est pas immédiatement perçue par le spectateur. Le réalisme, cette reconstruction du réel, est donc transparent. Colin MacCabe précise ce processus et la manière dont le texte filmique impose au réel son ordre et sa signification tout en contrôlant et en hiérarchisant les différents discours : « Le réalisme classique implique l’homogénéisation des discours par leur subordination à un discours dominant – lequel est assuré de sa domination par la sécurité et la transparence de son image« Classical realism […] involves the homogeneisation of different discourses by their relation to one dominant discourse – assured of its domination by the security and transparency of its image. The fact that one such practice involves this homogeneisation is a matter of ideological and political but not normative interest. ». » (MacCabe, 1976, p. 12) Le réalisme hollywoodien, selon MacCabe, consiste donc bien à refouler la dimension contradictoire du réel, à l’articuler harmonieusement de manière à lui ôter ses contradictions.
Mais il y a plus. Si l’on suit Stephen Heath, le cinéma narratif suppose que la représentation mimétique et perspectiviste assigne au spectateur une position fixe et inamovible face à l’objet qu’il contemple. La représentation mimétique détermine par avance la distance (ou la proximité) et la position dans l’espace du spectateur, via l’angle de la caméra ou le choix de la focale, elle l’enferme dans « l’espace distancié qu’instaure la perception optique » (Prigent, 1996, p. 27). Cette position spatiale du spectateur induit une position éthique ; le rapport du spectateur à la représentation implique et contient son rapport aux discours qu’elle véhicule. La « maîtrise de l’œil » tient par conséquent le spectateur sous le joug du discours (Prigent, 1996, p. 24-27). À l’inverse, les stratégies formelles adoptées par Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel font surgir ce qui, dans le réel, est contradictoire jusqu’à l’indéchiffrable et qui bat en brèche les processus d’assignation du regard, qui sont toujours des processus d’assignation à une idéologie (Prigent, 2004, p. 88-92).
De cette façon, Leviathan tâche d’expulser le spectateur hors du discours de l’œil, c’est-à-dire de la perspective anthropo- et logocentrée qu’il ne peut pas quitter dans l’expérience ordinaire qu’il fait du monde. Le film et sa bande-son construisent une perception qui adhère à celle du règne animal dans son entier, et non simplement limitée à l’espèce humaine – une perception à hauteur de mouettes et de poissons (fig. 3). Et le spectateur de faire l’expérience d’un arrachement à son regard d’être humain.

Figure 3
Bruit et abstraction : l’indéchiffrable contre la maîtrise de l’œil
Le bruit omniprésent, qui parasite la bande-image et la bande-son comme une mauvaise herbe, n’est pas un manque du film. Il change les plans documentaires du film en une matière plastique abstraite, proche du cinéma expérimental (fig. 4). Les plans immergés de Leviathan, où la caméra plonge et ressort de l’eau au rythme des cahots du navire, rappellent immanquablement East River de Bill Morrison, film de 5 minutes où le cinéaste immerge sa caméra dans les eaux de l’East River pour produire des images abstraites et informes, grâce aux déformations optiques provoquées par le liquide et son mouvement (fig. 5). Devant Leviathan, le spectateur retrouve certaines stratégies plastiques venues du cinéma expérimental. Sans le revendiquer explicitement, les réalisateurs avouent cet héritage d’un cinéma abstrait, ou d’un cinéma où la mimesis serait freinée par des stratégies formelles qui ne sont pas celles du documentaire ou du cinéma narratif : « Nous n’avions pas de grands principes mais quelques idées, comme celle de commencer le film dans un domaine abstrait et figural, et d’introduire doucement des éléments de repères. » (Momcilovic, 2013)

Figure 4

Figure 5
Quant au bruit de la bande-son, il est mixé – je dirais volontiers sculpté – selon des pratiques de sound design, dans le but d’en faire une performance noise ininterrompue, du début à la fin du film. Ernst Karel, connu pour ses travaux de field recordings, a supervisé le montage-son et le sound design à l’aide de Jacob Ribicoff. En utilisant plusieurs sources, ils ont élaboré une matière sonore complexe qui surdétermine la réception du spectateur. Celle-ci n’est plus le simple visionnage d’un film, elle devient une expérience sensorielle et physique ; le spectateur y participe avec sa vue, son ouïe, mais aussi son corps, à travers la douleur auditive que lui procure la bande-son. Celle-ci a été conçue pour être jouée à un volume supérieur aux usages en vigueur dans les salles de cinéma, de manière à surdéterminer/accentuer la perception auditive du spectateur par rapport à sa perception visuelle. De fait, la bande-sonore a fait l’objet d’un travail plus sophistiqué que la bande-image, et on peut ainsi très légitimement considérer Leviathan comme un objet sonore plutôt qu’un objet visuel. C’est ce travail qui a mené plusieurs critiques à dire qu’il s’agissait autant d’une performance de musique noise que d’un film. Les réalisateurs ne s’en sont pas cachés.
Il nous a paru tout de suite évident que nous devions accorder autant d’importance au son qu’à l’image. D’abord parce que l’intensité sensorielle de la vie à bord est autant acoustique que visuelle. Le moteur est si puissant que, de toute façon, il rend vaine toute tentative de conversation intelligible. Par ailleurs, le son est un élément moins codé que l’image, moins réductible à un « sens » : il est plus abstrait, plus évocateur, il convoque l’imagination. (Momcilovic, 2013)
Comme je l’ai écrit auparavant, le bruit – visuel comme sonore – devient dans Leviathan le facteur qui nous arrache à notre perception anthropocentrée et logocentrée pour proposer à la place la fiction d’une perception impersonnelle, à l’échelle du règne animal. Il s’agit bien là d’une fiction de la perception, le cinéma devenant ici un outil spéculatif proposant au spectateur de concevoir, à défaut d’éprouver, la perception, non pas d’un animal isolé, mais bien du règne animal dans son entier ; d’éprouver le chaos de la perception lorsqu’elle n’est pas corsetée par l’intelligence et la raison humaines. On voit, avec Leviathan, de quelle puissance est capable le cinéma lorsqu’il cherche à ouvrir la perception et à l’ôter à tout principe anthropocentré. Il défait les grilles de la mimesis et du traitement mathématique de la perspectiveJohn M. Krois : « Introduction », in Cassirer (1995, p. 21). – constitutives du regard humain dompté par la culture – pour fonder d’autres grilles perceptives, des modèles de représentation, de figuration et de perception alternatifsVoir Alberti (1436, p. 13-36) et de Vinci (1651, p. 175-201), où l’œil n’est plus enfermé dans « l’espace distancié qu’instaure la perception optique » (Prigent, 1996, p. 27) et où, par conséquent, il n’est plus assigné à aux idéologies (Prigent, 2004, p. 88-92).
En somme, le film arrache le spectateur à la maîtrise de l’œil et propose de voir, entendre et sentir à travers ce que Christian Prigent nomme un « orœil », organe hybride et fictif qui transcrit le réel autrement, hors de toute maîtrise optique et lisible : « Aucun “organe” n’écrit ni ne lit cela. Retiré à l’œil, pas vraiment donné à l’oreille. J’ai appelé cela ailleurs l’orœil. C’est le nom propre d’un ni-ni, l’étiquette de l’impuissance des noms et des rôles organiques à dire le brouillon énergétique du réel. » (Prigent, 1982, p. 142) Le concept d’orœil n’opère pas la substitution d’un organe perceptif à un autre mais bien une hybridation instable des modes de percevoir et de sentir, à la façon de l’expérience que propose Leviathan au spectateur : à savoir, adopter un mode de perception « qui puisse nous appeler à court-circuiter la distance et nous proposer de n’être plus tout entier assignés à la maîtrise de l’œil (à l’œil du maître) » (Prigent, 1996, p. 24-27). Dans le syntagme « l’œil du maître », on reconnaîtra le mode de perception et de pensée anthropocentré auquel le film s’attaque, de manière à détruire la loi dominante de la représentation et de la fiction, et qui s’impose comme incontournable et irréfutableVoir Barthes (1982, p. 16-19, 60-61 et 91).. Dans un texte antérieur à « Question d’orœil », Prigent précisait la teneur productive de son organe fictif, qui lui permet d’écrire « jusqu’à ne plus rien voir : trourien, plus d’images, de représentations, de vautours, de contours focalisés, etc. Ne plus voir, commencer à entendre. J’appelle ça l’orœil, par où vient l’ouïssance. […] Ce n’est plus pour l’œil, ce n’est pas tout à fait pour l’oreille : l’orœil est l’organe indécis qu’exige la langue. » (Prigent, 1979, p. 119) Cet organe indécis, c’est bien le corps perceptif sui generis que Leviathan propose au spectateur, un corps à la fois aviaire, pisciforme, humain et machinique, doté de fonctions visuelles, auditives et tactiles à la fois et mal différenciés les unes des autres, le film ne cessant de jouer sur le registre du de synesthésique et de la perception haptique (fig. 6).

Figure 6
On comprendra mieux la teneur de cette expérience spéculative d’arrachement à la perception humaine si on compare Leviathan à Under the Skin (Jonathan Glazer, 2014), qui partage lui aussi certains liens de parenté avec le cinéma expérimental. Under the Skin raconte le séjour sur Terre d’une créature extra-terrestre venue chasser les êtres humains comme un gibier. Outre sa dimension narrative – le film de Glazer emprunte aux genres de la science-fiction et du film noir pour construire son suspense –, Under the Skin tâche surtout de faire partager au spectateur l’étrangeté qu’éprouve la créature extra-terrestre lors de son immersion sur Terre. Les moyens de ce partage ne peuvent être que métaphoriques ; ils ne peuvent rien d’autre qu’amener le spectateur à tenter d’imaginer l’expérience du monde que ferait une créature d’origine extra-terrestre. À ce titre, ils font peut-être bien davantage éprouver l’impossibilité du partage et le caractère incommensurable des expériences.
Dans Under the Skin, l’étrangeté de l’expérience extra-terrestre est traduite par un usage non naturaliste du son et du bruit. Les prises de sons des différents environnements sonores (rues peuplées ou désertes de Glasgow, centres commerciaux, cafés, bords de mer, terrains vagues) que traverse l’extra-terrestre sont mixées de façon à ce que le spectateur perçoive une différence avec sa perception courante d’environnements sonores quotidiens. Chaque son semble plus précis, plus aigu que dans l’expérience courante ; chaque détail sonore semble mis en relief de façon à trouver une clarté nouvelle, comme si le bruit de fond du monde quittait sa qualité informe pour retrouver une netteté inouïe et à laquelle nous ne prêtons jamais attention. Johnnie Burn, l’ingénieur du son, a travaillé sur l’inframince, de manière à rendre infinitésimale la différence de perception sonore.
Dans ses Notes, Marcel Duchamp écrit qu’« entre deux objets faits en série [sortis du même moule] », il existe une « différence (dimensionnelle) » qui « est un inframince quand le maximum de précision est obtenu » (Duchamp, 2008, p. 24). Plus loin, il précise : « Deux formes embouties dans le même moule diffèrent entre elles d’une valeur séparative inframince. » (Duchamp, 2008, p. 33) Le concept d’inframince inscrit la possibilité de la différence dans les structures mêmes de la fabrication en série. Je la déplace quelque peu ici pour l’adapter aux structures de la reproduction sonore. Entre le réel et sa reproduction sonore, pourrait-on dire avec Duchamp, la différence est de l’ordre de l’inframince. Mais Duchamp suggère davantage dans sa définition : il fait de la différence moins un possible qu’un événement toujours actualisé, mais de manière invisible. L’inframince est, comme l’écrit Georges Didi-Huberman (2008, p. 279-280), « l’infinitésimal ou la différence impossible à reconnaître ». Il est « ce qui fait de l’opération reproductive une opération différentielle, une opération de l’écart ». De fait, « le problème de l’objet sériel [ou le problème de la reproduction sonore] n’est pas tant celui du même que celui de l’écart dans le même » (Didi-Huberman, 2008, p. 282).
La bande-son d’Under the Skin est d’autant plus étrange – au sens propre –, non familière et non naturaliste, qu’elle semble identique au réel sonore mais qu’elle s’en écarte de manière inframince. Cet écart, si infime soit-il, la rend précisément incommensurable au réel ; elle produit un effet d’« étrangisation », un concept forgé par Victor Chklovski en Russie au début du xxe siècleJe me permets de citer ici la note du traducteur, riche d’explications : « Par ce terme [étrangisation], nous traduisons littéralement le russe ostranénié, principal concept mis en avant par Chklovski dans ce texte, pour lequel ont été proposées d’autres traductions qui nous paraissent plus ambiguës par la confusion qu’elles peuvent introduire. “Singularisation” est trop marqué par son sens habituel, “défamiliarisation” implique un processus de retranchement au lieu d’ajout, “distanciation” renvoie à un autre terme d’histoire littéraire ayant un sens voisin mais non identique. À côté de ces mots, le terme d’étrangisation (estrangement en anglais) est aujourd’hui d’usage courant chez les commentateurs du formalisme russe. Il représente une notion proche de la “déformation” chez Roman Jakobson. » (Chklovski, 2008, p. 23-24). De même que, pour Chklovski, l’art a pour but « d’extraire l’objet de l’automatisme de la perception » (Chklovski, 1917, p. 25), la bande-son non-naturaliste d’Under the Skin soustrait le réel à la perception familière que nous en faisons, comme si nous écoutions désormais le monde à travers un autre appareil perceptif.
Cet inframince fait entendre combien la teneur globale de l’expérience du monde échappe à la verbalisation et combien toute différence de perception relève, de fait, de l’indicible. Dans Leviathan, Ernst Karel et Jacob Ribicoff ont fait le choix inverse. Plutôt que de travailler sur l’inframince, ils proposent une captation de l’environnement sonore qui défigure intégralement l’écoute du monde qu’a un être humain. La bande-son de Leviathan propose plutôt « un éventail de ressemblances par excès », qui « mettent à mal la “substantialité” » du réel (Didi-Huberman, 1994, p. 34). Dans les deux cas, par des moyens diamétralement opposés, il s’agit toujours d’utiliser le cinéma comme un outil spéculatif pour l’amener à imaginer l’expérience du monde que fait une autre espèce ; il s’agit toujours d’« étrangiser » la perception humaine. Les théoriciens formalistes russes ont pensé également la fonction politique de l’étrangisation. Percevoir différemment mène à penser différemment et, de fait, nous désassigne des idéologies auxquelles nous sommes usuellement assignés par la société. L’étrangisation est donc toujours aussi une opération d’émancipation. En dissolvant les automatismes perceptifs, les opérations d’écart conçues par Johnnie Burn, Ernst Karel et Jacob Ribicoff forcent le spectateur à déplacer son point de vue et à sortir de son cadre idéologique de référenceBernard Eichenbaum : « La théorie de la “méthode formelle” », in Todorov (1965, p. 44).. Je reviendrai plus loin cette question, que je laisse temporairement en suspens pour revenir à la question du bruit.
Quand y a-t-il bruit ? ou l’expérience de l’informe
À partir de la manière dont Leviathan met au travail le bruit dans la bande image et la bande son, nous pouvons, non pas tirer une définition figée du bruit, mais répondre à la question suivante : « Quand y a-t-il bruit ? ». Je suis en cela la démarche de Nelson Goodman dans Manière de faire des mondes, qui propose de substituer la question « Quand y a-t-il art ? » à la question impossible « Qu’est-ce que l’art ? », qu’il juge une « fausse question » (Goodman, 1992, p. 79-95) et qui par conséquent apporte plus de confusion que de clarté.
Il y a donc bruit quand le signal – vidéo ou sonore – revient à un état de chaos : lorsque l’image lisible et le son identifiable – c’est-à-dire les signes visuels ou sonores – sont défigurés, rendus illisibles par une quantité d’informations inorganisées, ou par une quantité trop importante de parasites. La figure (visuelle ou sonore) – la figura, pour reprendre le concept de Georges Didi-Huberman, forme à la fois mimétique et abstraiteVoir Delarge (2001, p. 11), Didi-Huberman (1990, p. 17-18) et Panofsky (1967, p. 23-26). – devient alors informe (fig. 7). Réciproquement, il y a bruit quand le chaos du réel est organisé en un signal et restitué en tant qu’ensemble informe de phénomènes. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un field recording (la matière première enregistrée par les micros dans Leviathan) est organisé, taillé, sculpté, mixé en vue d’une expérience bruitiste qui n’est pas réductible à l’écoute des sons de la nature, mais qui les organise. Au xviiie siècle déjà, Rameau affirmait que « toute cause qui produit sur mon oreille une impression composée de plusieurs autres, me fait entendre du son » (Rameau, 1750, p. 12-13), par opposition au bruit qui n’est, dans la pensé du compositeur, ni organisé ni composé.

Figure 7
J’entends ici le syntagme « expérience bruitiste » dans l’acception que John Dewey a donné au mot « expérience ». Le sujet « compose une expérience » (au sens d’expérience singulière) lorsque la matière de l’expérience (au sens abstrait, général du terme) acquiert une unité. Je parle donc d’« expérience bruitiste » dans la mesure où le bruit, dans certaines circonstances, gagne en homogénéité et en unité et se constitue en une expérience, de la même façon qu’un concert ou l’audition d’un disque « [compose] une expérience » pour le spectateur (Schaeffer, 1952, p. 123-133) : « Nous vivons une expérience lorsque le matériau qui fait l’objet de l’expérience va jusqu’au bout de sa réalisation […] conclue si harmonieusement que son terme est un parachèvement et non une cessation. » (Dewey, 2010, p. 80-81) Dewey conclut, après cette brève définition de l’expérience, de la manière suivante : « Une telle expérience forme un tout ; elle possède en propre des caractéristiques qui l’individualisent et se suffit à elle-même. Il s’agit là d’une expérience. » (Dewey, 2010, p. 80-81) Pour imaginer plus concrètement ce qu’est une expérience bruitiste, que l’on pense à ces moments où les sons de l’expérience quotidienne semblent se composer en un ensemble musical ; que l’on pense encore au cas des Futuristes italiens. Luigi Russolo et Filippo Tommaso Marinetti, par exemple, ont théorisé le bruit en vue d’en faire la matière d’une telle expérience bruitiste, qu’ils ont proposée au public lors de démonstrations d’intonarumori en juin 1913 à Modène et Milan, ou lors de concert à Milan, à Gênes et à Londres en 1914, dont le célèbre et houleux concert milanais du 21 avril 1914, où Russolo fait notamment jouer Risveglio di una cittàAnne Penesco : « Le Futurisme italien : bruits et sonorités », in Le Vot (2009, p. 127-142).. À tout point de vue, ce concert a constitué pour le public une expérience, par son caractère mémorable et parce qu’il a fait date dans l’histoire de la musique (Dewey, 2010, p. 83-86).
Revenons à présent à la question du bruit et de l’informe. Le bruit se manifeste comme phénomène lorsque la figura est envahie par les parasites et/ou quand elle quitte son état de figure pour devenir informe. Le bruit ne conjure pas absolument la forme ni la mimesis ; elle en est plutôt une transgression (fig. 8 et 9). « Il faut dire, écrit Didi-Huberman (1995, p. 20), non seulement que la transgression est liée à la forme ou à la limite qu’elle transgresse, mais encore que la forme constitue peut-être moins l’objet de la transgression […] qu’elle n’en constituerait le lieu fondamental. » Et il ajoute ces lignes, dont les images feront mieux sentir la vertu active et l’énergie spécifique du bruit : « La transgression n’est pas un refus, mais l’ouverture d’une mêlée, d’une ruée critique, au lieu même de ce qui se trouvera, dans un tel choc, transgressé. » (Didi-Huberman, 1995, p. 20) Le bruit agit donc comme une irruption parasitaire soudaine, un contre-espace qui s’ouvre dans l’espace visuel ou l’espace sonore pour en perturber (Didi-Huberman écrit « transgresser ») la logique et l’accomplissement usuels. Les mots « mêlée » et « ruée critique » correspondent de façon remarquablement précise à la teneur plastique du bruit visuel : un grouillement de parasites, une agitation pêle-mêle du signal à l’écran.

Figure 8

Figure 9
Le bruit n’est donc pas un état figé du signal et du signe, de la figure ou de la représentation, état qui serait chaotique, informe ou parasitaire ; il désigne bien plutôt le continuum et le processus dynamique qui font passer la figure par différents états de forme et d’informe. C’est aussi bien le continuum qui passe du signe au signal pur, puis au chaos ou à l’informe, et inversement de l’informe au signal pur puis au signe.
Je voudrais clarifier ici la terminologie que j’utilise. Dans tout signal, il y a du signe. Réciproquement, il n’y a pas de signe sans signal, qui lui-même est inséparable de son medium (Kittler, 1999, p. 2-3). Le signal porte le signe. Dans le signe, l’état du signal est un état de transparence : on l’oublie et on oublie notamment sa matérialité. Le couple signal/signe est alors dominé par le signe ; il se constitue en signe et occulte le signal. Mais lorsque le signal s’impose dans le couple signal/signe, sa matérialité passe à nouveau au premier plan et le signe, en tant que composé formé d’un signifiant et d’un signifié (dans lequel le signifiant porte un signifié qui renvoie lui-même à un référent), se disloque et devient informe. Je propose donc l’affirmation suivante, en manière d’axiome : lorsque le signal est lisible, il se constitue en signes ; lorsque les signes perdent en lisibilité, ils se réduisent au signal.
On peut donc comprendre le bruit comme le signe déterminé une fois qu’il a été rendu à l’infinité de ses possibles, ou comme le signal virtuellement riche de tous ses signes possibles. Plus qu’un état, le bruit serait un devenir incessant, sans terme ni finalité. Aussi le bruit ouvre-t-il un espace, dans lequel l’audition et la vision ne constituent plus une lecture mais sont rendues à leur indétermination première et s’ouvrent radicalement. Dans le bruit, l’audible et le visible deviennent indéchiffrables, tandis que dans notre expérience courante du monde, ils restent lisibles (fig. 10). Cet espace ouvre à son tour une pluralité de lectures ou de rapports possibles, qui se distribuent sur une échelle allant de la lecture transparente à l’illisibilité radicale. Cette pluralité de rapports possibles permet à Leviathan de proposer au spectateur une perception désubjectivée, en le soustrayant de force à la perception ordinaire, dans laquelle il est en quelque sorte enfermé.

Figure 10
En linguistique, le bruit désigne tout ce qui altère ou transforme la transmission d’un message, notamment en en altérant le code (Mounin, 1995, p. 71). Le bruit fait ainsi peser sur la lisibilité des sons et des images la menace d’un indéchiffrable, dont le spectateur fait l’expérience en regardant et en écoutant le film. Non seulement l’indéchiffrable engage le spectateur dans une écoute acousmatique, concept théorisé par Pierre Schaeffer et qui désigne le fait d’entendre sans voir la cause originaire du son ou de faire entendre des sons sans la vision de leur cause, à partir de la « dissociation de la vue et de l’ouïe » (Schaeffer, 1966, p. 93), mais il est à l’origine d’un hiatus entre la bande-son et la bande-image, ou d’une interruption de la synchrèse (Chion, 2000, p. 55). Ce que le spectateur voit à l’écran n’est jamais totalement l’origine de ce qu’il entend. La conséquence de cet indéchiffrable et de ce hiatus, s’ils étaient portés à leur point d’intensité maximale, serait un bouleversement des structures de la perception et de l’appareil perceptif humain lui-même. Il reste difficile, néanmoins, d’appréhender ce que pourrait être véritablement ce bouleversement des perceptions. Stan Brakhage en propose une approximation lorsqu’il évoque l’idée d’un œil innocent au début de Métaphores et vision :
Imaginons un œil non éduqué selon les lois de la perspective inventées par l’homme, un œil qui ne serait pas gouverné par la logique de la composition, un œil qui ne connaît aucune chose selon son nom ordinaire mais qui doit apprendre à connaître chaque objet qu’il rencontre au cours de sa vie à travers une aventure de la perception. Combien y a-t-il de couleurs pour le nourrisson qui gambade dans une pelouse et qui ne possède pas la notion de « vert » ? Combien d’arcs-en-ciel la lumière peut-elle créer devant l’œil non éduqué ? Quelles variations des ondes de chaleur cet œil peut-il capter ? Il nous faudrait imaginer un monde peuplé d’objets incompréhensibles, chatoyant d’une infinie variété de mouvements et d’innombrables nuances de couleurs. Un monde d’avant la Genèse, d’avant le logos, avant que ne s’écrive : « Au commencement était le Verbe » (Brakhage, 1998, p. 19)
Le monde que perçoit l’œil innocent de Stan Brakhage est un monde de bruits, c’est-à-dire un monde pas encore structuré et hiérarchisé par le logos, un monde où le langage est toujours déjà parasité par l’informe. Comme tel, c’est un chaos déstructuré de mouvements, de lumières et de couleurs qui ne renvoient à rien de ce que le langage peut nommer : un monde indéchiffrable car inexprimable.
Pour comprendre la nature de cet indéchiffrable, je me réfère ici au texte « L’informe » qu’a écrit Bataille pour la revue Documents, qui nous éclaire sur le pouvoir d’ébranlement de l’informe et, par conséquent, sur le pouvoir de transformation des perceptions et des discours que détient le bruit :
Un dictionnaire commencerait à partir du moment où il ne donnerait plus le sens, mais les besognes des mots. Ainsi informe n’est pas seulement un adjectif ayant tel sens mais un terme servant à déclasser, exigeant généralement que chaque chose ait sa forme. Ce qu’il désigne n’a ses droits dans aucun sens et se fait écraser partout comme une araignée ou un ver de terre. Il faudrait en effet, pour que les hommes académiques soient contents, que l’univers prenne forme. La philosophie entière n’a pas d’autre but : il s’agit de donner une redingote à ce qui est, une redingote mathématique. Par contre affirmer que l’univers ne ressemble à rien et n’est qu’informe revient à dire que l’univers est quelque chose comme une araignée ou un crachat. (Bataille, 1929, p. 382)
Bataille ne propose pas de définition positive de l’informe : l’informe est simplement le principe négatif qui défait toute forme, avant même qu’elle n’apparaisse. Dans la phrase « La philosophie entière n’a pas d’autre but : il s’agit de donner une redingote à ce qui est, une redingote mathématique », Bataille laisse entendre que la forme est quant à elle le principe qui sous-tend, comme un horizon, les discours, les savoirs et les disciplines scientifiques chargés de déchiffrer et de structurer le monde par le logos. La métaphore qu’utilise Georges Bataille, la « redingote mathématique », apparente la fonction de la forme à celle de la perspective telle que la concevaient Alberti (1436, p. 18-19 et 33-36.) et de Vinci (1651, p. 175-181 et 182-201). La forme, tout comme la perspective, est une grille perceptive qui sert à la computation et à l’ordonnancement du mondeVoir Panofsky (1975, p. 78 et 92-93), Cassirer (1972), et John M. Krois (introduction de Cassirer, 1995, p. 21).. Défaire la forme et agir contre elle revient à saper les discours, les savoirs et les disciplines qui structurent de part en part notre perception du monde et qui ont partie liée avec une vision ordonnée du monde.
Il faut donc comprendre l’informe selon Bataille comme le principe négatif ou dialectique d’un renouvellement de la perception du monde. Mais ce principe est dangereux, comme l’indique la teneur nihiliste de la phrase finale : « affirmer que l’univers ne ressemble à rien et n’est qu’informe revient à dire que l’univers est quelque chose comme une araignée ou un crachat ». Il s’agit là, pour Bataille, de destituer l’univers de sa qualité de totalité, de le vider des significations métaphysiques dont nous pourrions l’investir pour l’annuler et faire que l’univers – qui est tout – ne soit rien. L’informe sape les structures de perception et de connaissance, mais ne propose aucune autre structure à la place : il y a dans la proposition de Bataille un geste de déconstruction extrêmement puissant, dont la force tient à ce qu’il laisse, derrière lui, un néant. Mais il y a plus encore dans le geste discursif de Bataille. En imaginant un dictionnaire qui « ne donnerait plus le sens, mais les besognes des mots », il suggère que l’informe, en tant que principe négatif, peut se déployer et agir dans une infinité de domaines, qu’il ne circonscrit pas, préférant s’en tenir à l’univers. À nous, dès lors, d’imaginer lesquels.
Politique du bruit et menaces de l’indéchiffrable : déconstruire l’œil anthroponormé
J’ai écrit plus haut que le bruit rendait informe et indéchiffrable la figure du monde, qu’elle soit visuelle ou sonore. Je voudrais à présent expliquer pourquoi le bruit endosse, de cette façon, une valeur politique. En préambule, je rappellerai simplement la théorie des formalistes russes, qui voyaient dans l’« étrangisation » de la perception le vecteur de l’émancipation des consciences et donc d’une pensée politique révolutionnaireVoir Chklovski (1917, p. 23-24) et Bernard Eichenbaum (dans Todorov (dir.), 1965, p. 44).. Mais dans Leviathan, c’est un processus plus complexe qui confère au bruit sa valeur politique. Le bruit visuel et sonore constitue dans le film une stratégie globale de mise en crise des normes de perception et des discours anthropocentrés qui, à « la narration » et à « la clarté discursive », au « triomphe du code et de l’information », préfère « l’opacité de la vie » (Momcilovic 2013). En entraînant le spectateur dans une désubjectivation radicale, en l’arrachant de force à sa perception ordinaire, en le plongeant dans la bande-image et la bande-son comme dans un magma chaotique et illisible, le film propose au spectateur l’expérience de l’informe que décrit Bataille et déconstruit son rapport anthropocentré au monde.
On se demandera légitimement en quoi cela peut-il bien consister. Je répondrai qu’il s’agit, pour Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel, de proposer au spectateur le regard et l’écoute du règne animal lui-même ou, comme je l’ai écrit plus haut, la fiction d’une perception impersonnelle, à l’échelle du règne animal dans son entier. Plus simplement, le film propose, par les structures perceptives qu’il construit théoriquement, d’abolir la séparation traditionnelle entre l’espèce humaine et le reste du règne animal, division que détermine (et aussi bien qui détermine) le regard anthropocentré que nous portons sur le monde, lequel, avec l’aide de la philosophie occidentale, « a enfermé la spécificité humaine dans une clairière ontologique isolée de l’arbre des connaissances en sciences » (Pascal Picq in Guichet, 2008, p. 254-255). Je me permets ici de rapporter les propos des deux réalisateurs, qui expliquent la teneur de cette perception impersonnelle.
Ce qui est sûr, c’est que nous ne voulions pas que le point de vue du « réalisateur » occupe la place écrasante qu’il a dans la majorité des documentaires. Nous avons voulu relativiser le coté directorial, disperser l’autorité a tous les sujets impliqués, éviter a tout prix l’anthropocentrisme. D’ou cette représentation aux perspectives multiples, qui génère un rapport plus intime à ce qu’est la vie à bord d’un chalutier. Mais malgré cette fragmentation, il nous semble qu’il y a dans le film un point de vue très unifié, ou disons, quelque chose d’unifiant, presque organique. Le directeur de la cinémathèque de Harvard a écrit quelque chose qui nous touche beaucoup : selon lui c’est comme si, avec Leviathan, la nature elle-même avait fait son autoportrait. (Momcilovic 2013)
Il s’agit en somme de considérer l’ensemble des espèces appartement au règne animal et leur perception sur un pied d’égalité avec l’espèce humaine, sans rapport hiérarchique, dans une relation horizontale. Dans la classification scientifique des espèces, notamment dans la nomenclature binomale des espèces conçue par Linné, homo sapiens appartient d’ailleurs au sous-embranchement des vertébrés, à la classe des mammifères, à l’ordre des primates et à la famille des hominidésVoir Linné (1793, p. 32-36) et la toute première version de la classification, un opuscule de onze pages paru en 1735 : Carolus Linnæus : Systema naturæ, sive regna tria naturæ systematice proposita per classes, ordines, genera, & species, Leyden, Theodorus Haak, 1735.. En aucun cas on ne saurait l’isoler et l’opposer au reste du règne animal dans une dichotomie « homme/animal » qui demeure avant tout une construction sociale. La structure même de la classification scientifique des espèces nous apprend combien l’opposition « homme/animal » simplifie la complexité des parentés structurelles et biologiques entre homo sapiens et les autres hominidés, primates, mammifères et vertébrés. Cette simplification est d’autant plus nette que les théories postérieures à la classification linéenne – celle de Lamarck et celle de Darwin – insistent toutes deux sur l’évolution des espèces et, par ricochet, sur le caractère socialement construit de l’opposition entre l’homme et les animauxVoir Lamarck (1802) et Darwin (1859).. Enfin, la classification phylogénétique des espèces (dite aussi cladistique ou systématique phylogénétique) achève d’invalider cette opposition (Hennig 1950). Fondée sur le clade, une unité de classement qui désigne un ensemble d’organismes formant une totalité de descendance (soit un ancêtre commun et tous ses descendants – on parle aussi de groupe monophylétique), la phylogénétique raisonne en terme de proximité des espèces et non en termes hiérarchiques. Aussi peut-on définir le clade comme un ensemble d’organismes plus proches les uns des autres que d’aucun autre organisme, et comme une unité évolutive (Wiley 1981). Toutes les hiérarchies s’invalident dans la cladistique, puisque les homininés y sont plus apparentés au rat ou à la lamproie qu’au singe, ou que les crocodiliens y sont plus apparentés aux oiseaux qu’aux reptiles (Lecointre 2006).
En somme, Leviathan et Under the Skin nous permettent de penser et d’éprouver, à l’aide de moyens auditifs et visuels, le lien innommable entre homo sapiens et le reste du règne animal. Ils poursuivent par d’autres moyens les mêmes finalités que les critical animal studies, paradigme disciplinaire qui réinterroge la partition entre humanité et animalité ainsi que l’histoire de cette partition (Paola Cavalieri in Singer, 2006, p. 54-68). Par conséquent, les critical animal studies déconstruisent la position de pouvoir qu’occupe l’humanité à l’intérieur de la nature, position de pouvoir instaurée au cours de la Renaissance avec les trois principes fondateurs de la raison humaniste moderne : la rationalité, l’universalisme et l’homme comme maître et possesseur de la nature. Cette position est d’autant plus idéologique qu’elle résiste à la classification phylogénétique, fondée sur une approche calculatoire et probabiliste de la question du vivant (Darlu et Tassy, 1993, p. 195-223), difficilement contestable puisqu’elle dépasse et englobe les précédentes classifications : c’est là le signe de sa supériorité scientifique (Popper, 1988). À partir des sciences naturelles, de la philosophie politique et morale et de l’anthropologie, les critical animal studies entendent reposer la question de la souffrance et de la conscience animales, ainsi qu’interroger la condition faite aux animaux par les hommes. En miroir, elles interrogent donc aussi la place des êtres humains dans la natureVoir notamment Gary L. Francione (in Petrus et Wild (dir.), 2013, p. 249-268), Ted Benton (in Sanbonmatsu (dir.), 2011, p. 99-119), David DeGrazia (in Singer (dir.), 2006, p. 40-53)..
Dans son livre posthume L’animal que donc je suis, Derrida pose que la question de l’animalité est une question à la fois métaphysique et politique parce qu’elle engage un hypothétique « propre de l’homme », construit par la métaphysique et la théologie occidentales depuis la Renaissance. À travers la question de l’animalité, le philosophe cherche déconstruire la position fondatrice et originelle qu’occupe homo sapiens dans l’ordre naturel, position d’autant plus susceptible d’une critique qu’elle est décrétée par l’homme et pour son propre bénéfice (Derrida, 2006, p. 185-186).
Comment cette déconstruction opère-t-elle ? Le rapport de l’humanité à l’animalité est largement fondé sur la violence – c’est une « véritable guerre des espèces », écrit Derrida (2006, p. 54). Cette violence est à la fois génétique, industrielle, hormonale, expérimentale, mécanique et chimique ; elle a pris depuis deux siècles des proportions qui n’ont absolument plus aucune mesure commune avec la manière dont on traitait les animaux avant le xixe siècle (Derrida, 2006, p. 44-46). Le philosophe développe alors l’idée que cette condition faite aux animaux par les hommes entraîne en retour une « fascisation du sujet » (Derrida, 2006, p. 142). Il mène à bien sa démonstration en revenant à la manière dont Adorno (1993, p. 123-124) analyse l’absence de commisération de Kant (1785, p. 160-162) pour les animaux, en tant qu’ils ne sont pas doués de raison et d’autonomie et par conséquent de dignité.
Cette guerre des espèces semble d’autant plus effroyable qu’elle forme un système absolument rationnel, aux proportions génocidaires, mais qui ne vise que sa propre perpétuation :
De la figure du génocide il ne faudrait ni abuser ni s’acquitter trop vite. Car elle se complique ici : l’anéantissement des espèces, certes, serait à l’œuvre, mais il passerait par l’organisation et l’exploitation d’une survie artificielle, infernale, virtuellement interminable, dans des conditions que des hommes du passé auraient jugées monstrueuses, hors de toutes les normes supposées de la vie propre aux animaux ainsi exterminés dans leur survivance ou dans leur surpeuplement même. (Derrida, 2006, p. 46-47)
Selon Derrida, les rapports de pouvoir et de violence qui découlent de la position centrale et arbitraire de l’homme au sein du règne animal et de la violence infligée par les hommes aux animaux, se manifestent non seulement entre l’humanité et l’animalité, mais au sein de l’humanité elle-même, entre ses différentes ethnies. De la guerre des espèces à la guerre générale, il n’y a qu’un pas infime – celui qui prétend séparer l’homme du règne animal. Et s’il est vrai que « la guerre est une simple continuation de la politique par d’autres moyens » (Clausewitz, 1988, p. 67), la question animale est toujours déjà une question politique. Le générique sans distinction hiérarchique entre les noms des poissons et ceux des êtres humains dans Leviathan et le choix de Scarlet Johansson pour interpréter la créature extra-terrestre dans Under the Skin ne disent pas autre chose : l’étranger contre lequel nous dirigeons la violence est aussi celui qui nous est biologiquement le plus semblable (fig. 11). Les propos de Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel vont tout à fait dans ce sens :
Le film décrit une guerre inter-espèces, mais aussi une sorte de retour à un point où ces règnes se confondent. Les hommes ont souvent tendance à oublier qu’ils font partie de la nature. De ce point de vue, notre représentation de l’humanité est plutôt humble : elle est relativisée, recontextualisée dans une dimension écologique et cosmique beaucoup plus large. (Momcilovic, 2013)

Figure 11
Les propos que je rapporte montrent que le projet d’un film qui adopterait, comme une fiction, la perception du règne animal et la représentation de la guère qui fait rage au sein de ce règne sont intimement liés. Le mode de perception sui generis construit par le film est une vision critique de la guerre. Or, la guerre est aussi l’expression primitive de l’asservissement et de l’oppression. Au xviiie siècle, Rousseau pense la nécessité du contrat social en tant que sortie de l’état de nature avant tout pour garantir théoriquement la liberté des individus : c’est en se dessaisissant de leurs libertés naturelles que les hommes s’assurent la liberté collective qui fait d’eux des citoyens.
Ce passage de l’état de nature à l’état civil produit dans l’homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l’instinct, et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C’est alors seulement que la voix du devoir succédant à l’impulsion physique et le droit à l’appétit, l’homme, qui jusque-là n’avait regardé que lui-même, se voit forcé d’agir sur d’autres principes, et de consulter sa raison avant d’écouter ses penchants. Quoiqu’il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu’il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s’exercent et se développent, ses idées s’étendent, ses sentiments s’ennoblissent, son âme tout entière s’élève à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l’instant heureux qui l’en arracha pour jamais, et qui, d’un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme. (Rousseau, 1762, p. 186)
À la suite de Hobbes, qui définit l’état de nature comme « la guerre de chacun contre chacun » (Hobbes, 1651, p. 224), Rousseau repense l’état de nature comme la cause première de l’asservissement des hommes. Déconstruire les présupposés du rapport de violence généralisée qui lie les hommes aux animaux et les hommes entre eux, c’est tenter de désamorcer cet état de guerre qui asservit mutuellement les individus, et c’est aussi œuvrer à leur émancipation.
Conclusion
Dans Leviathan, le bruit est le premier maillon du processus qui conduit du chiffrement de la bande-image et de la bande-son jusqu’à la déconstruction des rapports de violence entre les individus et les espèces, puis à leur émancipation. La violence nous enferme dans la servitude mais le bruit, en déconstruisant les fondements même de la violence, contribue à enrayer les mécanismes de l’asservissement. Bien plus que l’« harmonie (parfois grinçante) » dont parle Althusser au sujet des appareils idéologiques d’État (Althusser, 1976, p. 90) , et qui n’est qu’un simple dysfonctionnement sans conséquence pour l’idéologie dominante, le bruit est, comme l’écrit Dick Hebdige dans un texte consacré aux contre-cultures (2008, 77-94), un principe esthétique qui met en échec les pouvoirs hégémoniques en créant en leur sein une « interférences parasitaire ». Dans Leviathan, il produit de l’illisible et de l’informe de façon à parasiter la violence comme mécanisme de l’asservissement et du pouvoir. Le processus qui se déploie dans le film est bien différent de celui que décrit Dick Hebdige. Alors que les contre-cultures analysées par Hebdige – comme le mouvements punk par exemple – opèrent à l’aide de signes distinctifs, en opposant des pratiques culturelles ou rituelles minoritaires aux us et coutumes de la culture dominante, Leviathan propose d’accomplir le processus de mise en échec de l’hégémonie à travers une ethnographie animalière presque exclusivement sensorielle, fondée sur le bruit et la confusion des sens du spectateur – qui devient alors le canal par lequel s’accomplit la critique de l’anthropocentrisme.